Voyager autrefois. Lettres inédites de la baronne Decouz
par Maurice Messiez
Article paru en avril 1993 dans L’Histoire en Savoie magazine
 En 1802, le commandant Pierre Decouz, revenu d'Egypte, se retrouve en garnison à Grenoble. Fils d'un bourgeois d'Annecy, alors âgé de vingt-sept ans, il rencontre, par relations, une jeune femme, Louise Michel, née à Laragne dans une famille de notables protestants, laquelle est rentrée de Paris avec son fils Edouard après le décès de son mari, l'avocat Grand-Thorane. En 1807, le colonel Decouz l'épouse ; l'année suivante, le couple acquiert un domaine à Francin, à mi-distance d'Annecy et de Grenoble, ville proche de La Terrasse, où les parents Michel se sont installés, leur famille possédant aussi des propriétés vers Coise et Planaise. Le général Decouz meurt des suites de blessures reçues à Brienne, le 18 février 1814.
En 1802, le commandant Pierre Decouz, revenu d'Egypte, se retrouve en garnison à Grenoble. Fils d'un bourgeois d'Annecy, alors âgé de vingt-sept ans, il rencontre, par relations, une jeune femme, Louise Michel, née à Laragne dans une famille de notables protestants, laquelle est rentrée de Paris avec son fils Edouard après le décès de son mari, l'avocat Grand-Thorane. En 1807, le colonel Decouz l'épouse ; l'année suivante, le couple acquiert un domaine à Francin, à mi-distance d'Annecy et de Grenoble, ville proche de La Terrasse, où les parents Michel se sont installés, leur famille possédant aussi des propriétés vers Coise et Planaise. Le général Decouz meurt des suites de blessures reçues à Brienne, le 18 février 1814.
Madame Decouz perd peu après un des deux fils encore vivants qu'elle a eus du général, Octave, le cadet. A l'aîné, Joachim, filleul de Murat, qui se fixe à Francin, elle va, de Paris où elle s'est finalement installée, écrire régulièrement à partir de 1830, sans être toujours payée de retour. Ses lettres d'un style alerte et parfois spirituel sont fort précises, riches de réflexions sur les événements de l'actualité, sur ses relations, sur la société parisienne ainsi que sur la Savoie.
Ainsi donc, grâce à Madame Decouz, une suite d'articles nous fera revivre un quart de siècle entre Francin, bien pauvre village d'une Savoie étouffée par la restauration sarde et un Paris qui se transforme, étale bientôt son luxe. La baronne Decouz meurt le 23 juin 1857.
Sur la route
 Chaque été, le plus souvent en juillet, Madame Decouz, comme ses amis des beaux quartiers, quitte Paris pour la campagne. Tous reviennent généralement en décembre pour la saison des spectacles, des bals, des réceptions, des dîners. Durant ce long séjour à Francin, Madame Decouz se rend plusieurs fois à Grenoble où habite son frère Duffléard (surnom attaché à un domaine). Par exemple, le 23 juillet 1834, évoquant un déplacement à Uriage, elle note que c'est « dispendieux » puis, le 7 septembre, remarque : « Arrivée hier ici par une chaleur effroyable et avoir été obligée de faire la montée de Barraux à pied en plein midi ». Ce sont là deux contraintes qui sont pour la voyageuse une préoccupation constante, liée pour la seconde à l'état des routes et des véhicules, aux aléas de la saison ; pour la première, il faut préciser que, jusqu'en 1835, Madame Decouz voyage dans sa propre voiture, avec son domestique comme cocher, et n'utilise qu'ensuite les moyens de locomotion collectifs.
Chaque été, le plus souvent en juillet, Madame Decouz, comme ses amis des beaux quartiers, quitte Paris pour la campagne. Tous reviennent généralement en décembre pour la saison des spectacles, des bals, des réceptions, des dîners. Durant ce long séjour à Francin, Madame Decouz se rend plusieurs fois à Grenoble où habite son frère Duffléard (surnom attaché à un domaine). Par exemple, le 23 juillet 1834, évoquant un déplacement à Uriage, elle note que c'est « dispendieux » puis, le 7 septembre, remarque : « Arrivée hier ici par une chaleur effroyable et avoir été obligée de faire la montée de Barraux à pied en plein midi ». Ce sont là deux contraintes qui sont pour la voyageuse une préoccupation constante, liée pour la seconde à l'état des routes et des véhicules, aux aléas de la saison ; pour la première, il faut préciser que, jusqu'en 1835, Madame Decouz voyage dans sa propre voiture, avec son domestique comme cocher, et n'utilise qu'ensuite les moyens de locomotion collectifs.
Le 5 juin 1835 donc, elle annonce son dernier départ avec sa voiture. Il lui faut tout organiser : « Il serait bien à désirer que j'eusse... une température pas trop chaude... il faut souffrir de la chaleur et de la poussière, surtout les pauvres chevaux. Paul (le domestique) me dit qu'il faudrait peut-être faire mettre des roues neuves ou bien changer la voiture contre une autre. C'est ce que je ne ferai pas... Je n'ai point fait mettre de galons neufs, je les ferai recouvrir avec l'indienne qu'on a nettoyée et nous verrons ensuite à nous en défaire à Chambéry ». Ce n'est finalement que le mercredi 8 juillet qu'elle se met en route, car elle attendait la fin du semestre pour toucher la pension versée, sa vie durant, à Joachim, fils mort à la guerre (500 francs). « Comme j'ai fait recouvrir la voiture pour le voyage, il ne me serait pas trop facile ou du moins trop dispendieux de prendre la poste ; ma voiture de cette manière étant assimilée aux berlines, il me faudrait payer quatre chevaux pour Marie (sa bonne) et pour moi. Enfin, je verrai car je veux faire ma route le plus commodément possible ; et d'abord la voiture sera peu chargée. J'ai fait remplir la malle d'Antoine des effets de Marie et l'ai fait partir par le roulage. Le coffre contient nos effets, linges, etc.… et ceux de Paul. Le reste se composera de l'attirail des chevaux, vos bouteilles de cirage et la toile cirée que Paul a très bien rangée.
Décidément, je passerai par Le Pont-de-Beauvoisin, je gagnerai un jour, ce qui est beaucoup. Au reste, je tâcherai de t'écrire en route, tu sauras donc précisément l'heure de mon arrivée à Chambéry. Aie soin d'envoyer à Chapareillan, de même pour les journaux qui suivent à dater de demain 8. Nous n'irons demain que jusqu'à Montereau où nous coucherons » (7 juillet 1835).
A partir de Lyon, Madame Decouz avait le choix entre deux routes : celle qui passait par Grenoble, qu'elle utilisera le plus souvent, celle qui passait par Pont-de-Beauvoisin. Ce dernier itinéraire lui permettait de raccourcir le voyage d'un jour, mais l'obligeait à prendre des passeports alors qu'à Chapareillan, si ses fils « avaient l'occasion de revoir ou de prévenir le commandant, il n'y avait pas de mal ». Chapareillan, dernier poste-frontière, à trois kilomètres de Francin, offre toutes facilités, par rapport à Pont-de-Beauvoisin, pour passer « gratuitement » et, de plus, « recueillir » les journaux interdits en Savoie. On comprend aussi qu'ayant une voiture relativement importante, puisqu'assimilée à une berline, Madame Decouz veuille éviter les relais de poste et même les relais pour ne pas être obligée de doubler son attelage en payant la location de deux chevaux supplémentaires (1,50 francs chacun par poste de deux lieues plus un postillon au même prix). Quant à la malle mise au roulage, elle lui permet certes d'alléger sa voiture, mais elle lui revient cher, environ 23 francs, et met au mieux vingt-cinq jours pour arriver, à raison d'environ vingt-quatre kilomètres quotidiens, les marchandises n'étant pas « roulées » la nuit, sauf à prendre le roulage accéléré, bien plus cher, et réduit sur cet itinéraire à Paris-Lyon. Au retour, sa malle vagabonde encore davantage : « Paris, 3 janvier 1836. Croirais-tu que la malle que j'ai fait porter à Chapareillan chez Eustache Arragon le 7 novembre pour de là m'être expédiée à Grenoble et Paris ne m'est pas encore parvenue '? ».
 Par contre, le 23 décembre 1841, elle avertira avec satisfaction que «la caisse de beurre est arrivée hier en parfait état par le roulage de Grenoble ici en huit jours et n'a pas coûté cher de prix ».
Par contre, le 23 décembre 1841, elle avertira avec satisfaction que «la caisse de beurre est arrivée hier en parfait état par le roulage de Grenoble ici en huit jours et n'a pas coûté cher de prix ».
Le 7 juillet 1837, elle annonce son départ annuel pour la Savoie ; « Ma place est arrêtée aux Messageries françaises, nouvel établissement magnifique à l'entrée de la rue Montmartre dans un bien beau local et bien près de chez moi... ce qui a son agrément ; ses voitures sont deux coupés et point d'intérieur à six places, ce qui est atroce. Elles sont charmantes et paraissent bien confectionnées; d'ailleurs, tu connais le proverbe « tout nouveau, tout beau ». Je partirai jeudi 13 à 4 heures après-midi et arriverai à Lyon à 4 heures du matin (le dimanche). Je tâcherai de repartir le même soir pour Grenoble où je serai rendue le lundi ; j'y passerai la journée et prendrai la diligence de Chapareillan mardi matin, qui arrive dans cet endroit à 11 heures ou midi. Ainsi, mon cher enfant, tu auras la complaisance de m'envoyer chercher avec le char par Antoine. Si le temps ne change pas, la poussière ne manquera pas car il y a plus d'un mois qu'il n'a pas tombé une goutte d’eau ».
Madame Decouz a donc mis trois jours et demi pour gagner Lyon (distant de Paris de 475 kilomètres), ce qui fait moins de six kilomètres à l'heure. Vitesse inchangée depuis la fin de l'Empire. Sa diligence a roulé la nuit, elle a fait deux haltes chaque jour, l'une pour le déjeuner, l'autre pour le dîner, chacune durant trois quarts d'heure, mais les nombreux relais ont pris chaque fois un quart d'heure. De Lyon à Grenoble, par La Frette, le voyage dure normalement seize heures et de Grenoble à Chapareillan, il faut compter environ huit heures. On arrive ainsi à un total de près de cent dix heures de route entre Paris et Chapareillan. Ces presque six cents kilomètres sont-ils dispendieux ? A cette date, Madame Decouz ne donne pas de précisions, mais nous en aurons plus tard. Le problème, c'est que les tarifs étaient variables, ils « obéissaient à la loi commerciale de l'offre et de la demande : quand les voyageurs abondaient, à l'époque des chasses et des vacances, les prix s'élevaient…, en hiver, au contraire, ils étaient diminués de manière à attirer les voyageurs. Il y a d'abord le prix de la place elle-même : en coupé (à l'avant), c'est entre 50 et 60 centimes la lieue (quatre kilomètres pour la lieue de poste) soit 65 francs environ pour Paris-Lyon, 14 francs pour Grenoble, moins pour Chapareillan où la rotonde (places arrière) n'existait pas, soit 5 francs. Ajoutons le pourboire fixé communément à 13 centimes et demi par poste (deux lieues), environ 10 francs, enfin la nourriture «au-dessous de vingt francs » pour trois jours et demi de voyage, selon le rapport des entrepreneurs de messageries en 1833. Stendhal, quant à lui, remarque en 1837 que «la médiocre pension des RP Chartreux » revient à cinq francs par jour. Alors, au total ? 114 francs pour une personne. Quelle valeur aujourd'hui ? C'est toujours le problème. Un ouvrier menuisier gagnait alors 2,50 francs par journée dans l'Isère, une bonne vache valait entre 60 et 80 francs (aujourd'hui de 6 à 8 000 francs). De plus, Madame Decouz emmenait ses domestiques, même si elle les faisait voyager en classe économique. Pas de doute, c'était très cher (voir tableau page 37). En 1838, le bateau à vapeur peut suppléer les chevaux sur une partie du parcours. Est-ce toujours un progrès ? Voyons ce qu'en dit notre épistolière.
« Paris, 12 décembre 1838
 Nous sommes arrivés ici samedi 8 à trois heures du matin, heure bien désagréable dans cette ville. Ayant malheureusement pris la route de Bourgogne, il a fallu attendre à Chalon neuf heures les voyageurs de la diligence à qui il avait plu de choisir la « voye » du bateau à vapeur qui remonte avec beaucoup de lenteur, la Saône étant extrêmement grosse et débordée en ce moment, tandis que si j'avais pris la même diligence (Notre-Dame des Victoires) qui est très bien menée et très bonne, qui passe par le Bourbonnais, j'aurais gagné bien du temps. Je serais partie de Grenoble par le courrier ou la diligence de M. Leborgne qui arrivent tous deux à 5 ou 6 heures du matin à Lyon et je serais repartie également à 9 heures du matin par la diligence route du Bourbonnais Je serais arrivée vingt heures plus tôt. Si cette « voye » te convenait, je crois que tu t'en trouverais bien. Depuis le premier de ce mois, le prix des places est diminué, le coupé 46 francs 50 centimes, l'intérieur 40 francs 50 centimes et la rotonde 40 francs 50 centimes. Ils m'ont paru aussi plus coulants pour le poids des bagages car ils m'ont passé au plus de dix livres par personne (sic). Si tu emmènes Antoine (ce nom a déjà été cité, il s'agit du domestique de Joachim), tu pourrais le mettre dans la rotonde comme j'ai fait de François et Marie et toi dans le coupé. Il y a comme tu vois une grande différence entre la malle-poste qu'il faut faire retenir si longtemps d'avance.
Nous sommes arrivés ici samedi 8 à trois heures du matin, heure bien désagréable dans cette ville. Ayant malheureusement pris la route de Bourgogne, il a fallu attendre à Chalon neuf heures les voyageurs de la diligence à qui il avait plu de choisir la « voye » du bateau à vapeur qui remonte avec beaucoup de lenteur, la Saône étant extrêmement grosse et débordée en ce moment, tandis que si j'avais pris la même diligence (Notre-Dame des Victoires) qui est très bien menée et très bonne, qui passe par le Bourbonnais, j'aurais gagné bien du temps. Je serais partie de Grenoble par le courrier ou la diligence de M. Leborgne qui arrivent tous deux à 5 ou 6 heures du matin à Lyon et je serais repartie également à 9 heures du matin par la diligence route du Bourbonnais Je serais arrivée vingt heures plus tôt. Si cette « voye » te convenait, je crois que tu t'en trouverais bien. Depuis le premier de ce mois, le prix des places est diminué, le coupé 46 francs 50 centimes, l'intérieur 40 francs 50 centimes et la rotonde 40 francs 50 centimes. Ils m'ont paru aussi plus coulants pour le poids des bagages car ils m'ont passé au plus de dix livres par personne (sic). Si tu emmènes Antoine (ce nom a déjà été cité, il s'agit du domestique de Joachim), tu pourrais le mettre dans la rotonde comme j'ai fait de François et Marie et toi dans le coupé. Il y a comme tu vois une grande différence entre la malle-poste qu'il faut faire retenir si longtemps d'avance.
Tout est arrivé ici à bon port, y compris la caisse de vin... Bénie soit la main qui a fait ce bon vin (de Francin). N'oublie pas de m'envoyer promptement le nom des aimables douaniers de Chapareillan car il me tarde de les recommander à Monsieur Gratin, leur directeur général ».
Tout est détaillé, les deux routes de Paris à Lyon, la baisse des tarifs, le prix du voyage en coupé passant de 65 à 46,50 francs, celui en rotonde de 45 à 40,50 francs. Cette diminution est le résultat de la concurrence entre entrepreneurs et de celle faite aux diligences de la route du Bourbonnais par la mise en service des bateaux à vapeur sur la Saône, c'est à-dire sur une bonne partie de la route Paris-Lyon par la Bourgogne. Les entrepreneurs pouvaient supporter cela car leur marge bénéficiaire était considérable : c'est ainsi que les sept associés du courrier du commerce qui desservait la ligne Grenoble-Lyon par Vienne avec deux petites diligences de dix places retiraient un bénéfice quotidien de 70 francs (vingt-huit journées de travail d'un ouvrier) ; ainsi les frères Charvet qui faisaient circuler plus de vingt diligences de Grenoble à Lyon, Gap, Valence, Chambéry, étaient parmi les plus imposés du département (365,95 francs de patente en 1841 pour Benoît). Le courrier dont parle Madame Decouz est une voiture rapide, réplique des Charvet à la Société des Berlines du Commerce de Grenoble à Lyon, montée en 1826 par Moine, Leborgne et Cie pour desservir dans les meilleures conditions de temps Lyon et Grenoble par Voiron, Les Abrets, La Tour du Pin avec deux voitures de neuf places. « Elles partent tous les jours de Grenoble à Lyon à midi précis et arrivent le lendemain à 7 heures du matin ». De 1831 à 1841, Charvet avait dû se contenter de maintenir sur la route une « malle-poste » de quatre places, puis était passé à un « courrier » de douze places. Par contre, ses diligences ont un monopole sur Grenoble-Lyon par La Frette où elles transportent trois voyageurs de coupé, six de berline (à l'intérieur), quatre de rotonde, trois d'impériale. Elles vont forcément moins vite que la malle-poste qui file à près de dix kilomètres à l'heure. Ceci explique que, « lorsque les chemins sont bons », une lettre postée le 12 janvier 1839 à Montmélian arrive le 15 au matin à Paris, ainsi que le note Madame Decouz qui recommande en outre à son fils de ne pas s'arrêter à Lyon où on « s’ennuie et où on habite des hôtels qui sont si détestables, car l'hôtel des Ambassadeurs, où je m'arrête maintenant, est aussi sale et aussi mal tenu que les autres ».
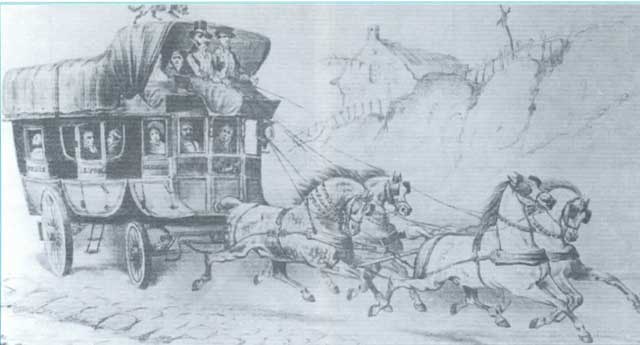 Si Madame Decouz peste contre certains inconvénients du bateau à vapeur durant les années 1838 à 1842, elle ne rejette pas toujours pour autant ce moyen de transport. Par exemple, en mai 1839, elle se rend à Rouen chez des amis où elle est somptueusement reçue, remarquant pourtant : « Ce qui vaut mieux que tout cela, c'est le voyage du Havre que Monsieur Bourguignon m'a fait faire par le bateau à vapeur aller et retour par un temps superbe. Le port est des plus curieux... Je suis revenue à Paris ravie ». Et cette même année, à Joachim qui lui conseille le bateau, elle réplique : « Le voyage par le bateau à vapeur que tu m'indiques m'aurait singulièrement plu pour aller jusqu'à Aix (les Bains), mais il faut coucher en route, ce qui est fort désagréable ». Il faut remarquer que le bateau n'est jamais sûr : «24 juillet 1842. Mon départ aura lieu demain lundi 25 à 4h 1/2 après-midi par la diligence du Commerce, rue Croix des-Petits-Champs. Route de la Bourgogne : si le bateau à vapeur marche, nous prendrons cette direction et à Lyon la diligence l'Estafette dont tu m'as fait l'éloge. Comme elle arrive, me dit-on, à 5h du matin à Grenoble... (je) partirai de suite par la diligence de Chambéry. De cette manière, je pourrai être rendue à Chapareillan jeudi 28 où je te prie de m'envoyer chercher. Je pars d'ici avec Madame de Montluisant, une de mes amies, fille du général La Salcette et sa jeune fille. Nous avons le coupé à nous trois ». Cette Estafette est probablement le «Velocifer courrier de commerce» exploité depuis le Ier novembre 1840 par une société en participation (actionnaires) qui concurrence Charvet et Leborgne en faisant relayer ses deux voitures tous les treize à dix-sept kilomètres; elles ne mettent théoriquement que 12h15, en réalité 13 heures.
Si Madame Decouz peste contre certains inconvénients du bateau à vapeur durant les années 1838 à 1842, elle ne rejette pas toujours pour autant ce moyen de transport. Par exemple, en mai 1839, elle se rend à Rouen chez des amis où elle est somptueusement reçue, remarquant pourtant : « Ce qui vaut mieux que tout cela, c'est le voyage du Havre que Monsieur Bourguignon m'a fait faire par le bateau à vapeur aller et retour par un temps superbe. Le port est des plus curieux... Je suis revenue à Paris ravie ». Et cette même année, à Joachim qui lui conseille le bateau, elle réplique : « Le voyage par le bateau à vapeur que tu m'indiques m'aurait singulièrement plu pour aller jusqu'à Aix (les Bains), mais il faut coucher en route, ce qui est fort désagréable ». Il faut remarquer que le bateau n'est jamais sûr : «24 juillet 1842. Mon départ aura lieu demain lundi 25 à 4h 1/2 après-midi par la diligence du Commerce, rue Croix des-Petits-Champs. Route de la Bourgogne : si le bateau à vapeur marche, nous prendrons cette direction et à Lyon la diligence l'Estafette dont tu m'as fait l'éloge. Comme elle arrive, me dit-on, à 5h du matin à Grenoble... (je) partirai de suite par la diligence de Chambéry. De cette manière, je pourrai être rendue à Chapareillan jeudi 28 où je te prie de m'envoyer chercher. Je pars d'ici avec Madame de Montluisant, une de mes amies, fille du général La Salcette et sa jeune fille. Nous avons le coupé à nous trois ». Cette Estafette est probablement le «Velocifer courrier de commerce» exploité depuis le Ier novembre 1840 par une société en participation (actionnaires) qui concurrence Charvet et Leborgne en faisant relayer ses deux voitures tous les treize à dix-sept kilomètres; elles ne mettent théoriquement que 12h15, en réalité 13 heures.
En tout cas, outre que la rapidité n'est pas la qualité première de la diligence de Chambéry à Grenoble, on y fait aussi de curieuses rencontres : «24 9bre 1842. Mon cher Joachim, je suis arrivée à Chapareillan avant la diligence qui était déjà garnie de trois horreurs de montagnards des Baugeu (sic), des charbonniers bien sales, bien laids, borgnes, qui n'ont pas cessé une minute de bavarder leur affreux patois. Il n'y avait plus que deux places que j'ai prises. Nous ne sommes arrivés ici qu'à 5 heures, j'ai donc été obligée de séjourner aujourd'huy (à Grenoble) ». Nouveau malheur pour elle : « Je ne partirai pas de Lyon par le bateau à vapeur, j'ai appris ici qu'ils ne marchaient plus à cause de la crise des eaux ». Conclusion, la bonne vieille diligence a du bon : «5 décembre 1842. J'ai fait un très bon voyage, sans être même du tout fatigué. Arrivée à Lyon par le courrier de Grenoble, je suis descendue précisément dans le bureau des diligences du Commerce, de sorte qu'il n'y a point eu transport d'effets et ce bureau se trouve attenant à l'hôtel du Parc où nous avons couché. J'ai été parfaitement contente de ces diligences qui sont excellentes et devancent les autres de 7 à 8 heures. Nous sommes arrivés ici dans le milieu de la journée. Elles sont bon marché car il y a beaucoup de concurrence, 50 francs le coupé, 40 1'intérieur et 32 la rotonde ». Le coupé est nettement plus cher, le confort se paie.
 En juin 1843, elle fait pour la dernière fois l'ensemble du trajet en diligence, car à l'automne elle rentrera à Paris avec le train pour une partie du parcours. Cette nouveauté n'est pas que joie pour elle : « 12 novembre 1843. Mon voyage s'est fait par un très beau temps, les routes sont sèches comme dans l'été.
En juin 1843, elle fait pour la dernière fois l'ensemble du trajet en diligence, car à l'automne elle rentrera à Paris avec le train pour une partie du parcours. Cette nouveauté n'est pas que joie pour elle : « 12 novembre 1843. Mon voyage s'est fait par un très beau temps, les routes sont sèches comme dans l'été.
J'ai eu bien des déceptions quant au chemin de fer, des retards aux relais du côté de Roanne ; nous avions un mauvais conducteur, lent, celui qui conduisait la diligence lorsque ce grand malheur, que tu auras sans doute lu dans les journaux, est arrivé à Tarare. Nous sommes arrivés à Orléans deux heures après le départ du chemin de fer qui a eu lieu à 6 heures du soir. Si nous eussions été à temps, nous arrivions à Paris à 9h 1/2, tandis qu'on nous a fait partir par ce qu'on appelle le convoy de nuit qui part à 10 heures et qui ne mène que les bagages, marchandises, etc... Nous avons fait une station de plusieurs heures à Etampes au milieu de la nuit, au débarcadère. Juge s'il y avait de quoi rager. Enfin, nous ne sommes arrivés à Paris que le matin. Il n'y a qu'à moi que ces sortes de choses arrivent car Arragon et tous les autres voyageurs, chaque jour, sont en mesure de partir à temps. Ce chemin de fer est charmant et la manière dont on place la diligence sur les wagons est ingénieuse et vraiment merveilleuse. A peine si l'on s'en aperçoit. Les transports à présent sont bien bon marché; depuis Lyon à Paris, on va pour 45 francs dans le coupé de la diligence, 33 dans l'intérieur et 25 dans la rotonde ». Ce sont là des conséquences de l'introduction du chemin de fer que refusent les « notables », entrepreneurs de transport par voitures à cheval.
LES VOYAGES FRANCIN - PARIS
Année / Moyen de transport / Durée du voyage / Prix du voyage / Valeur en journées de travail d’un ouvrier / Pouvoir d’achat quotidien en kilomètres
1835 / Voiture personnelle genre berline / largement une semaine / / /
1837 / Diligence / 110 heures / 114 francs / 46 jours / 12 kilomètres
1842 / Diligence + bateau à vapeur (Dijon-Lyon) / 71 heures / 95 francs / 38 jours / 14,5 kilomètres
1844 / Diligence + chemin de fer (Orléans) / 55 heures / 80 francs / 30 jours / 18 kilomètres
1852 / Diligence + chemin de fer (Chalon-sur-Saône) / 34 heures / ? (mais en baisse) / ? (en baisse) / ? (en hausse)
1992 / TGV (F classe) / 4 heures / 522 francs / entre 1,5 et 2 jours / 400 kilomètres
Et vint le rail
Désormais, pour ses voyages en Savoie, Madame Decouz va utiliser chaque fois le chemin de fer, en modifiant son itinéraire suivant les progrès de l'extension du réseau. Or cette extension est fort lente car, malgré les projets précoces concernant l'axe Paris-Lyon, celui-ci ne fonctionnera qu'en 1852. Les intérêts locaux, tant ceux des particuliers que des villes, voire même du département de l'Isère, s'opposent à son arrivée: on craint la ruine. En juin 1844, notre voyageuse passe donc de nouveau par Orléans : «22 juin 1844. Conformément à tes conseils, j'ai arrêté il y a quelques jours mes places dans la diligence Notre-Dame des Victoires pour partir à 7h 1/2 le matin par le chemin de fer d'Orléans le samedi 6 juillet. On m'a dit au bureau de la diligence que nous arriverions à Lyon le dimanche à 11 heures du soir... Nous voudrions partir de Lyon le lendemain matin lundi à 6h du matin par la coureuse pour Chambéry où l'on arrive le même soir ». De Paris à Lyon, elle met donc alors 39h 30 qui sont à comparer aux 84 heures de 1837.Si on ajoute un petit progrès dans la rapidité des diligences, on constate que le temps de voyage, certes sans passer par Grenoble, a été divisé par deux. En 1845, le chemin de fer lui fait encore gagner près de deux heures; elle remarque cependant: « Je préférerais cent fois la route que tu me dis par la malle-poste de Genève : je ferais un voyage charmant et traverserais un pays que je ne connais pas, mais je suis forcée de passer par Lyon et de m'y arrêter » (22 juillet 1845).
Le retour, dans l'hiver 1846, est plus mouvementé : «25 Xbre 1846. Après un bien mauvais temps, de la glace, de la neige, de la pluye, un vent et une tempête épouvantables et enfin toutes les intempéries de la saison, un froid de - 12,5 à – 14° depuis Grenoble et à Lyon, je suis arrivée ici par le chemin de fer d'Orléans pris dans cette ville à 7h 1/2 du matin et arrivée à 1lh du matin aussi en très bonne santé. Je ne te raconterai pas toutes les phases de mon voyage, ce serait trop long, seulement que nous avons versé dans la voiture du courrier où j'étais, entre La Frette et Champié: personne n’était blessé, un cheval seul a été tué sur place. Je suis partie de Grenoble à 1lh du soir vendredi 18 « jour néfaste pour moi et arrivée donc mardi 22 ». L'émotion de l'accident lui a peut-être fait oublier l'insuffisance du confort car, dans les mêmes conditions hivernales, elle s'exclamait le 6 décembre 1840 : « De Grenoble à Lyon, j'ai bien souffert du froid dans ce maudit coupé de diligence, quoique nous fussions trois hermétiquement fermés ».
L'année suivante, Joachim et sa belle-fille Eugénie (l'épouse de son premier fils Edouard Grand-Thorane) viennent passer plusieurs semaines auprès d'elle. Elle s'inquiète de n'avoir pas de nouvelles une semaine après leur retour en Savoie : «22 mai 1847. Tu t'es mis en route avec l'individu le plus affreux de la chrétienté, quoique ministre protestant (elle-même l'était). Son horrible hideur a fait sensation dans la cour de la poste et un pareil être ne peut que porter malheur dans un voyage. Je ne conçois pas que Monsieur Pillet-Will ait osé conduire dans sa voiture un aussi vilain Chinois, sale et mal mis. Ce qui me comble, c'est que ce n'est que dans la malle-poste de Genève qu'on rencontre de ces espèces-là. Dans la diligence, ils sont mieux mêlés aux voyageurs ». Apparemment, les jugements de Madame Decouz sont souvent sans pitié, mais le contexte montre que les mots employés ne correspondent pas toujours à ses sentiments profonds.
En 1847, un nouvel itinéraire s'offre à elle, qu'empruntent Messieurs Léonide et Viviand. Il s'agit d'aller par le chemin de fer à Orléans puis Tours et de là gagner Bourges ; ensuite, avec la diligence, en passant par Nevers, de rejoindre Lyon : « Je serais assez tentée de faire ce même trajet si cela ne prolonge pas trop le voyage et si ce n'est pas beaucoup plus cher » (12 juin).
L'a-t-elle fait ? Le 3 juillet, elle annonce qu'elle part : « Demain, lundi 5, je prends la route d'Orléans (chemin de fer) par la diligence Notre-Dame des Victoires qui part à 8h du matin de Paris et arrive à Lyon le lendemain soir à 8 heures. On arrive bien plus tôt et depuis une dizaine de jours le prix des places a beaucoup diminué ». En temps, elle gagne 15h30 et tout ira mieux encore, même pour le trajet en diligence, à son retour à Paris : « Lyon, 25 9bre 1847. Nous sommes arrivés dans cette ville à 5h du matin ; le service de cette diligence se fait merveilleusement, on n'attend pas une minute aux relais. Si j'eusse pu prévoir cette célérité, je me serais arrangée pour partir aujourd'huy à 10h, qui est l'heure fixée pour le départ de Paris. Voici les renseignements que je viens de prendre auprès d'un monsieur du Bureau, fort poli, qui me les a donnés très en détail. On passe par Moulins et l'on va jusqu'à Saint-Pierre là, on prend la route qui conduit à Bourges à 6h du soir (donc je ne perdrai pas ma place en allant voir la cathédrale que je ne connais pas ; là, on prend le chemin de fer que l'on parcourt de nuit puisqu'on arrive à Paris dimanche à 5h du matin, ce qui fait donc depuis Lyon 42 heures. Il n'y a cependant que 70 lieues par terre, m'a-t-on dit, de Lyon à Bourges. Tu vois qu'il n'y a pas d'avantage de prendre le chemin de fer. Les routes ne sont pas mauvaises, ces longueurs sont incroyables... On ne sait comment passer le temps dans cette ennuyeuse ville où il y a un brouillard des plus épais. Je suis logée au Parc où j'ai une chambre avec un beau balcon donnant sur la place mais qu'on ne voit pas à cause du brouillard ».
Les suites de la Révolution de 1848, c'est-à-dire les événements de juin, retardent son départ car on a suspendu la délivrance des passeports et il y a foule au guichet : « Je ne pouvais me mettre en route sans en avoir un, par le temps qui court c'eût été très imprudent. Enfin, je le tiens ». Elle part finalement le 5 juillet. L'année suivante, elle se décide à passer par Bourges en partant le mardi 26 juin « dans la journée ». Elle est à Lyon le jeudi matin et constate : « Je suis arrivée ici pas plus fatiguée que si je sortais de mon lit dont la diligence m'a un peu tenu lieu car je n'ai fait qu'un sommeil depuis Paris ici, excepté à Bourges et à Roanne où l'on s'est arrêté pour dîner ». Madame Decouz a alors 69 ans. « Je suis contente de quitter Lyon qui a un aspect bien triste malgré le soleil brillant et radieux. J'ai secoué la poussière dont j'étais couverte, je me suis débarbouillée » (28 juin 1849, Hôtel du Parc à Lyon).
Elle ne savait pas ce qui l'attendait lors de son retour à Lyon le 28 décembre 1849. « Je suis dans un désespoir affreux ; ma cassette en cuir jaune, que tu avais donnée... à cet animal de domestique de porter au bureau de la diligence... a été oubliée à la douane de Pont-de-Beauvoisin. Le directeur de cette diligence m'a promis qu'il ferait en sorte que cette cassette m'arrive bien vite... Toute ma fortune, valeurs, papiers précieux, tout est dedans. Je suis donc plantée ici à me morfondre : depuis hier et aujourd'hui la neige n'a pas cessé de tomber, il y en a trois demi-pieds ». Le 29 décembre, les diligences arrivent sans la cassette : «Je meurs de chagrin, je pars ce soir à 7h par la diligence Notre-Dame des Victoires. La Saône est presque gelée, les bateaux à vapeur ne marchent pas ». L'attente est longue, mais le 5 janvier la cassette est là, intacte : elle contenait pour 100 000 francs de valeurs, somme énorme évidemment, près de 8 millions de francs en 1992. Comme quoi la sécurité des bagages pouvait ne pas être mauvaise. « 6 janvier 1850. J'ai reçu hier soir samedi la malheureuse cassette ; tout était en retard, diligence, courrier. Les routes étaient si mauvaises à cause des glaces, de la neige que nous avons trouvée jusqu'à Paris où nous sommes arrivés le 1er de l'An à 5h du matin ; nous étions partis samedi 29 (de Lyon). Les bateaux à vapeur sur la Saône ne marchaient pas à cause de la glace, ni le chemin de fer de Chalon à Dijon à cause de l'encombrement de la neige, ce qui avait (aussi) dérangé le service du relais. Tout le long de la route beaucoup de neige, un peu moins à Tonnerre où nous avons manqué le convoy seulement de trois minutes ; il a fallu attendre celui du soir à 11h45 minutes. Du reste, ce chemin de fer va admirablement bien et est superbe, point de tunnel ».
Au printemps 1850, Madame Decouz multiplie les projets de voyage autour de Paris, envisage d'aller en Angleterre et se rend finalement à Soissons : « Le voyage est charmant par le bateau à vapeur sur l'Aisne et de là par le chemin de fer de Compiègne à Paris, tout cela en peu d’heures ».
Il n'empêche qu'alors le bateau à vapeur restait problématique. Le 17 juillet 1850, elle conserve l'itinéraire passant par Bourges, le chemin de fer allant maintenant « jusqu’à Nérarde parce que je ne courrai pas la chance que le bateau à vapeur ne marche pas, les eaux de la Seine étant très basses en cette saison ». Elle emmène ses deux domestiques, « leur voyage étant si bon marché à présent qu'il me coûterait plus cher de les laisser à Paris ».
Les choses se révèlent finalement moins simples et, de Lyon, elle explique à Joachim : «3 Xbre 1850. Nous avons fait un affreux voyage de Chambéry à Lyon par cette affreuse patache d'où l'on nous a transbahutés au Pont-de-Beauvoisin dans une autre qui ne valait guère mieux. Nous sommes restés à la douane 2h25 minutes et l'on a visité et fouillé tous les effets, jusqu'au moindre petit bout de ruban... Et aux Abrets, on a recommencé une autre visite en nous faisant tous descendre dans un terrible courant d'air. Nous sommes arrivés dans cette ville à 10h12 ce matin. Je me souviendrai de cette maudite voiture pour ne jamais la reprendre ».
Même si, pour elle, le bateau accumule les inconvénients par rapport au chemin de fer («14 décembre 1850. Le brouillard sur la Saöne retarde le bateau »), elle continue de s'interroger : « 21 juillet 1851. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont parties par Aix mais je n'en ai pas vu arriver, tel que M. Viviand qui nous a beaucoup vanté le voyage par le bateau à vapeur arrivant du Bourget, partant de Lyon, pour le prix de 2 francs, ce qui lui souriait infiniment, son équipage allant de Chambéry les chercher là. Mais de Francin ? ».
Sagement donc, elle s'en tient au chemin de fer : le 24 juillet, un jeudi, elle utilise les messageries Notre-Dame des Victoires (départ 9h 1/2 du matin) puis le chemin de fer de Chalon et arrive le vendredi soir à Grenoble ; le voyage a duré un jour et demi, soit 36 heures. Même choix pour le retour à Paris en décembre 1852 : «4 Xbre 1852. J'en suis partie (de Lyon) à 6h le même jour par la diligence Notre-Dame des Victoires et nous sommes arrivés par des routes superbes à Chalon à 5h du matin où nous sommes restés jusqu'à 6h30 minutes où nous avons pris ce magnifique et délicieux chemin de fer en nous arrêtant dans ce parcours aux stations : une fois 20 minutes pour dîner et deux autres fois dix minutes chaque. Nous sommes arrivés à Paris hier à 4h 1/4 de l'après-midi ». De Lyon à Paris, 22h et pour aller à Grenoble ou Chambéry plus de la moitié de ce temps ! Et la diligence n'est pas toujours sûre : « 14 Xbre 1852. Si je n'eusse lu dans les journaux... que deux courriers avaient été pillés, entre autres celui passant à Tournus le 5... Je crains que ma lettre n'ait eu le sort de toutes les autres ». Mais non, c'était la précédente.
Les progrès techniques dans les moyens de transport sont indéniables ; en est-il de même en ce qui concerne l'établissement de tarifs rigoureux ? Notre voyageuse en doute : « Je te prie, quand tu iras à Chambéry, de passer au bureau de la diligence de Grenoble et de réclamer de suite de ma part à M. Boisson, à qui j'ai écrit à ce sujet, 1,50 franc. Ce n'est pas pour cette somme si minime mais c'est pour ne pas être dupe de ces tours de passe-passe, m'ayant fait payer des places en arrivant à Grenoble plus qu'il n'était convenu avec lui-même ».
Par ailleurs, le chemin de fer et la diligence ont beau la conduire avec rapidité jusqu'aux Marches en août 1853, un problème se pose ensuite à elle : son fils n'a plus de chevaux. Elle ralliera Francin à pied avec Annette : « C’est mieux de passer par
Grenoble plutôt que par Chambéry où l'on arrive fort tard le soir, 10h, et, quoique je ne sois pas peureuse, il serait imprudent à deux femmes seules d'être vues sur la route à cette heure-là ». Ce choix d'une solution qui exige détermination et mépris de la fatigue (elle a alors soixante-quatorze ans) cache mal son mécontentement à l'égard de Joachim qui s'est refusé à renouveler son équipage malgré les conseils qu'elle lui a prodigués et les bonnes occasions qu'elle lui a signalées...
En 1854, au moment de l'adjudication du chemin de fer de Lyon à Grenoble, dans lequel Lepasquier, le beau-frère de Joachim, est actionnaire, elle pose la question : « Que dit-on de celui de Savoye ? A-t-on commencé les travaux de terrassement Cette même année, le 29 juillet, elle annonce que désormais «il n'y a pas à s'arrêter sur place ce jour et ce départ fixe », elle peut donc se présenter à la gare quand il lui convient. Ajoutons qu'à cette date, la diligence Grenoble-Chapareillan a abaissé à quatre heures la durée du trajet.
C'est en 1855 qu'elle fait son dernier voyage, pour lequel elle prévoit qu'elle aura « bien certainement le désagrément d'attendre (à Lyon) jusqu'au soir (la diligence de Grenoble où elle ne sera) rendue que le matin ».
Elle n'aura donc pas utilisé la ligne Lyon-Grenoble, ni le « Victor Emmanuel » mais, la connaissant, on peut assurer qu'elle aurait été heureuse d'emprunter l'une ou l'autre jusqu'à Montmélian. Moins d'un siècle et demi plus tard, le TGV s'arrêtera au pied de son domaine de Francin, à trois heures de son domicile parisien.
{backbutton}




